Léon Gleyze
Légende :
Panneau commémoratif en l’honneur de Léon Gleyze, le Balèze
Genre : Image
Producteur : Michel Seyve
Source :
Détails techniques :
Photographie numérique
Lieu : France - Auvergne-Rhône-Alpes (Rhône-Alpes) - Drôme - Le Pègue
Analyse média
À l’entrée du hameau de Célas – commune de le Pègue –, dans un arbuste, a été fixé sur deux supports métalliques fichés en terre, un panneau commémoratif d’environ 40 cm de largeur sur 60 à 70 cm de hauteur. Le texte, en bleu et rouge sur fond blanc (couleurs du drapeau national), rend un hommage tout à la fois discret, fort et chaleureux, à Léon Gleyze, un habitant du hameau, rebelle à l’occupant en 1943-1944. À ce moment-là, deux maquis étaient installés dans la montagne de la Lance, le plus proche bien au-dessus de sa ferme, elle-même plus haute que ce lieu de mémoire et à quelques minutes de là en voiture. De ce même endroit, partent deux chemins dont l’un conduisait à la ferme et à l’un des camps. L’ancienne ferme de Léon Gleyze est actuellement restaurée et appartient à M. et Mme. Robert Clément ; sa photo est exposée dans l’album. Cette sorte de stèle, en structure légère, à l’entrée de Célas, dont le cliché peut être observé également dans l’album, interpelle le promeneur. Le message est concentré sur la personnalité résistante du paysan :
Toute Sa Vie Vécut Ici Léon Gleze 1890-1982 Homme Modeste Patriote Discret Cœur D’or Résistant Exemplaire En 1943 -44 il Logea, Nourrit, Guida Vers les Camps de La Lance De Nombreux Jeunes Opposants Aux Nazis. Cinquantenaire De La Libération Le 14 Août 1984 Lors de l’inauguration du panneau LEON GLEYZE à Célas, le 14 août 1994, Alain Chauvin lut le texte rédigé par son épouse – dont le tapuscrit est exposé en album – entièrement consacré au paysan patriote. L’inauguration du 14 août a été l’occasion d’une cérémonie marquante. La rencontre se déroulait devant la plaque même décrite plus haut. Martine Piallat-Chauvin, à qui l’Association des maquis de la Lance avait demandé de faire le portrait de Léon Gleyze à l’époque de la Résistance, avait mené son enquête dans la commune du Pègue où il vivait et où elle avait vécu elle-même, son père, Marcel Piallat, ayant été longtemps maire de la commune ; il était également résistant et fut interné au Fort Montluc à Lyon le 12 juin 1944. Elle rédigea ensuite le discours dont il est question. Elle habite maintenant la Roche-Saint-Secret, l’un des points de départ des sentiers empruntés par les maquisards en 1943 – 1944 pour rejoindre leur campement en montagne. Ce témoignage était en fait destiné au programme prévu pour la célébration du cinquantenaire des maquis de la Lance, le 4 avril 1993. En voici le texte intégral.
Léon GLEYZE Situé au pied de la Lance, au fin fond du village, au Pègue, à l’écart de la route, la ferme de Léon Gleyze est à l’abri des regards. Elle se niche dans le creux de la colline au point de s’insérer dans le paysage. L’homme qui vivait dans ce lieu et qui le faisait vivre était à son image : discret. Il fallait aller jusqu’à lui pour le rencontrer car il venait rarement au village. Né dans ce lieu, il y a toujours vécu. Il était, comme les pruniers greffés alentours de la ferme, par son père : un sauvage sur lequel s’était greffée l’amitié. Aussi, entre la montagne et le village, il vivait seul mais non solitaire. Il accueillait à bras ouverts les visiteurs ; s’il était célibataire, il y avait une femme dans sa vie, sa sœur, Sophie, qui vivait à Célas [hameau au pied de la Lance, le Pègue]. Mais surtout, il avait ses amis, ceux avec qui il savait partager sa passion pour la chasse. Massif, solide, de haute taille, on comprenait tout de suite pourquoi tous l’appelaient « le Balèze ». Balèze, ce surnom ne signifiait pas seulement son physique mais aussi sa personnalité ; c’était un balèze dans la connaissance de sa montagne et, balèze aussi, dans sa manière d’assumer son flegme et courage, ses charges de citoyen, le moment venu, quand les remous des événements historiques ont atteint sa retraite. En effet, en 1943, quand les maquis de la Lance se sont formés, il a tout naturellement conservé son réseau d’amis. La seule différence est que les amis ne venaient plus chasser et manger le lièvre, mais cacher armes et résistants. Le Balèze est devenu passeur : l’emplacement secret de sa ferme en faisait le relais parfait entre la plaine et la montagne. Réfractaires au STO et Résistants transitaient chez lui une nuit ou une journée avant de rejoindre les fermes de la Lance où commençait leur vie de maquisards. À partir de ce moment, Léon Gleyze, le Balèze, n’a plus eu de frissons seulement en traquant le lièvre ou le sanglier, mais aussi en devenant lui-même gibier terré dans sa ferme en compagnie de quelques jeunes et de fusils cachés dans le foin ; chaque visite devenait un danger. Il n’a pu bien sûr éviter les pertes ; mais grâce à son sang froid, il s’en est toujours sorti. Ainsi, quand les Allemands sont arrivés dans la région, ils n’ont pas manqué de faire une visite à Léon. Ce jour-là, les Allemands avaient pris au Pègue Simon Fourcade pour les guider jusqu’à la ferme de Léon Gleyze, où six résistants étaient avec leurs armes. Les nazis ont pénétré dans la ferme avec leur brutalité et leur autorité coutumières ; mais ils sont restés figés en découvrant l’intérieur d’un célibataire berger chasseur et grand lecteur du Dauphiné. Un peu partout s’étageaient des piles de vieux journaux. Les numéros des derniers mois envahissaient un coin de la table, garnie par ailleurs des restes des derniers repas. Bien sûr, le balai n’avait pas servi depuis longtemps et le chiffon poussière encore bien moins. Quant au maître des lieux, à une époque où bien souvent on ne se faisait la barbe qu’une fois par semaine, il paraissait sans doute, aux fringants Allemands, tout aussi peu reluisant. Mais le Balèze, lui, ne pensait pas à l’effet produit par son décor. Il se demandait que dire, que faire, face à un si grand danger. Rien ne lui vint à l’esprit, rien d’autre que les gestes ancestraux de l’hospitalité. « Vous prendrez bien un verre ! », eut-il la présence d’esprit de proposer à ses visiteurs inopportuns, en leur tendant un verre sur la table et en prenant la bouteille de rouge. Alors, les ennemis effectuèrent un repli stratégique que n’aurait pas obtenu la meilleure des mitrailleuses. Ils reculèrent et sortirent, tenus en respect par un verre d’un bleu violacé, très peu altéré par de symboliques rinçages. Les fils du IIIe Reich, éduqués prophylactiquement, s’enfuirent devant les dangereux microbes contenus dans ce verre hospitalièrement offert. Ils rebroussèrent chemin sans s’aventurer à perquisitionner. Plus tard, quand le danger fut écarté et les ennemis partis du village, Simon Fourcade, qui racontait l’aventure à Marcel [ Piallat ], précisa goguenard que le Balèze lui avait paru bien pâle ce jour-là. Marcel ne jugea pas bon d’expliquer la raison de cette pâleur qui, à lui, était bien compréhensible. Ce même jour, Simon Fourcade a aussi écarté le danger de Serre-Colon [Roche-Saint-Secret] où se trouvaient une vingtaine de maquisards. Car, quand les Allemands lui ont demandé le chemin de cette ferme, il leur a dit qu’elle était vieille, écroulée, et qu’il n’y avait personne. Par chance, ils l’ont cru, peut-être aussi avaient-ils peur d’une embuscade. Malgré la frayeur connue ce jour-là, Léon a continué ses activités clandestines. À la Libération, il n’a pas cherché à obtenir un quelconque honneur officiel ; l’estime de ses amis lui suffisait. La guerre finie, il a repris ses activités de berger et de chasseur. Il s’est rapproché du village quand sa sœur a vieilli, pour lui tenir compagnie. Il s’est installé chez elle à Celas et y est resté. C’est là, à plus de quatre-vingt-dix ans, que s’est éteint Léon Gleyze. Obscur et digne, fier de son indépendance, jusqu’au bout, il a été un balèze.
Une brève précision doit être signalée à la suite de cette page vivante : Léon Gleyze était effectivement lecteur du Dauphiné Libéré après la Libération ; mais ce journal a été créé précisément à ce moment-là, dans la foulée du Petit Dauphinois, plus ou moins compromis avec l’occupant. Le nouveau journal a tenu à prendre ses distances du précédent en affirmant d’emblée un esprit opposé dans son titre même, le terme de Libéré ne laissant apparemment aucun doute. Les piles de journaux auxquelles il est fait allusion sont donc des journaux de l’époque ; peut-être même, sans doute, car il n’y avait pas grand choix en 1943-1944, Le Petit Dauphinois ! Il est possible que ce discours ait été prononcé une autre fois, près de la ferme qui abrita l’un des camps, lors de l’inauguration de la stèle érigée à l’occasion du cinquantenaire des maquis de la Lance, au printemps 1993.
Auteurs : Claude Seyve, Michel Seyve
Sources : Martine Piallat-Chauvin
Contexte historique
L’action de Léon Gleyze, telle qu’elle nous apparaît à travers ces témoignages, est un élément constitutif – aussi modeste qu’indispensable – de ce que l’on nomme les maquis de la Lance. On peut trouver, dans les documents liés à cette notice, des éléments essentiels permettant de saisir la singularité de ces maquis, ce qui les distingue nettement d’autres maquis drômois dont ceux, pourtant proches, installés dans le Nyonsais et les Baronnies. Mais le comportement du Balèze n’est-il pas à situer également dans le climat des mentalités d’une époque ? Lorsque l’on veut approcher sa personnalité, on ne peut s’empêcher de songer à ce qu’un jeune voisin de ce moment-là, Joseph Coutton (rescapé d’une fusillade) de Valréas (Vaucluse), pensait du soutien des paysans aux résistants, ou encore à l’attitude d’un autre voisin, Albin Vilhet, petit paysan de Nyons (actif membre du Comité de Résistance local). Le premier, sur la base de son propre vécu de réfractaire et de Résistant, allait jusqu’à assurer : « Les paysans, on le dira jamais assez ce qu’ils ont été pour nous. Ils ont été nos amis, ils ont été nos guides, ils ont été notre famille. Sans les paysans, la Résistance aurait été impossible ». Le second, singulier à plus d’un titre, avait ceci de commun avec Léon Gleyze, qu’il était un ancien de la Première Guerre mondiale : il n’est donc pas étonnant que l’un et l’autre, chacun à leur manière, aient été attachés, comme un assez grand nombre de poilus, à une certaine idée de la France, de leur patrie, et, plus enracinée encore, de leur pays natal. De là à ne pouvoir tolérer, au fond d’eux-mêmes, l’idée de l’invasion, stoppée en 1914-1918, subie et doublée d’un abandon en 1939-1940, il n’y a qu’un pas. Sans doute ont-ils accepté les contraintes liées aux exigences d’une petite exploitation agricole, mais en préservant une réelle disponibilité pour l’aide aux jeunes réfractaires au travail en Allemagne (STO) et à la lutte contre l’envahisseur d’une manière générale. Naturellement le soutien de la paysannerie n’a pas toujours été aussi spontané ni général en France que dans les cas évoqués ! Il reste que son efficacité mérite d’être observée et sa présence soulignée comme un fait socio politique d’importance, ainsi que cela a été noté par François Marcot. « L’engagement des paysans dans la Résistance relève de leur culture et de leurs pratiques. Les valeurs de solidarité auxquelles ils sont attachés les prédisposent, dès l’été 1940, à l’accueil et à l’hébergement des pourchassés […]. On ouvre sa porte, on offre le gîte et le couvert et ce d’autant plus volontiers que l’étranger est présenté par une personne de connaissance. Chez les paysans se recrutent aussi de nombreux passeurs occasionnels et mieux que personne, ils connaissent les caches, les gués et les sentiers. Dans la lutte contre le travail forcé en Allemagne, qui marque vraiment leur entrée en résistance, les paysans allient cet esprit de solidarité au patriotisme antiallemand et au rejet de la collaboration de Vichy pour héberger les réfractaires et soutenir les maquis.[…] Dans leur engagement, les paysans restent fidèles à leurs pratiques traditionnelles : accueil, chasse, braconnage […]. »
Auteurs : Claude Seyve, Michel Seyve
Sources : Béatrice Jouve, Geo Chabert, Patrick Biolley, Martine Piallat-Chauvin, Archives ANACR 26 Comité Drôme provençale ; Dictionnaire historique de la Résistance, Dir. François Marcot, éd. Robert Laffont, Bouquins, p. 903, Paris, 2006.

Léon Gleyze en compagnie d’un ami, Arie Braakman (1914-2003) sur la chaise, après la guerre 1939-1945 ; archives personnelles Mme et M. Pierre Clément ©
 Léon Gleyze
Léon GleyzeLéon Gleyze et sa sœur, à Célas (le Pègue), après la guerre 1939-1945 ; archives personnelles Mme et M. Pierre Clément ©
 Plaque en l'honneur de Léon Gleize
Plaque en l'honneur de Léon Gleize Léon Gleyze
Léon GleyzePanneau commémoratif en l’honneur de Léon Gleyze dans un taillis au hameau de Célas, commune de le Pègue (Cliché Claude Seyve ©)
 Léon Gleyze
Léon GleyzeTapuscrit de Martine Piallat-Chauvin, original 21 X 29,7, 1 p. ½ ; recto ©
 Léon Gleyze
Léon GleyzeTapuscrit de Martine Piallat-Chauvin, verso ©
 Léon Gleyze
Léon GleyzeFerme de Léon Gleyze, appartenant actuellement à M. Robert Clément, située au pied de la montagne de la Lance (1340 m) ; cliché, Michel Seyve ©
 Léon Gleyze
Léon GleyzeFerme de Léon Gleyze, maintenant restaurée ; cliché, Michel Seyve ©
 Léon Gleyze
Léon GleyzeLogo créé à l’occasion du Cinquantenaire des Maquis de la Lance (1943-1993). Il est utilisé pour le balisage des chemins empruntés par les visiteurs qui tiennent à rendre hommage aux résistants ; ces sentiers étaient autrefois pratiqués par les maquisards. L’un d’eux passe à proximité de la ferme de Léon Gleyze.


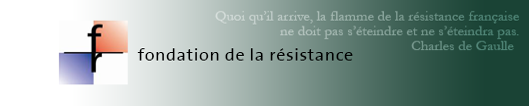
 Voir le bloc-notes
()
Voir le bloc-notes
()