Guy Eberhard à l’hôtel Lutétia à Paris, fin mai 1945
Légende :
Guy Eberhard à l’hôtel Lutétia à Paris, fin mai 1945.
Genre : Image
Type : Photo
Producteur : Inconnu
Source : © Collection Guy Eberhard Droits réservés
Détails techniques :
Photographie argentique noir et blanc.
Date document : Mai 1945
Lieu : France - Ile-de-France - Paris - Paris
Analyse média
Il porte encore la tenue rayée sur les vêtements qu’on lui a remis ; ses cheveux ont commencé à repousser et il a repris du poids.
Auteurs : Robert Serre
Contexte historique
Revoir la terre de France, c’était vraiment l’un des souhaits les plus chers des déportés. Les survivants ont eu une somme incroyable de hasards heureux, de chances. Et c’est la fin de la guerre qui permet qu’il y en ait. Car ce qui distingue les morts des rescapés, ce ne sont que quelques jours, quelques semaines entre le moment de leur libération et celui, tout proche, où ils auraient disparu à leur tour. « Nous étions des morts revenus par hasard » écrit Violette Maurice, rescapée de Ravensbrück.
L’arrivée à Paris de tous ceux qui rentrent d’Allemagne, prisonniers ou déportés, commence en avril 1945. En septembre 1944, un ministère aux prisonniers, déportés et réfugiés avait remplacé le simple commissariat. Dans la capitale, les modalités d’accueil avaient été préparées correctement… pour des prisonniers de guerre. Mais personne n’imaginait qu’il y aurait tant de gens à secourir, et avec une telle urgence. On avait des renseignements sur les prisonniers, mais on ne savait pas grand chose sur les déportés politiques et encore moins sur les déportés raciaux.
En même temps que les 1 200 000 prisonniers de guerre, en avril et mai 1945, arrivent 700 000 travailleurs requis du STO (Service du travail obligatoire), des réfugiés de toutes sortes, des Alsaciens-Lorrains enrôlés de force dans la Wehrmacht et les déportés. Comment faire face à un tel afflux, dans un pays abattu ? Ce qui n’était pas prévu non plus, c’est que les responsables de l’accueil se trouvent devant des êtres squelettiques, habillés comme des clochards, souffrants, au regard encore apeuré, protégeant instinctivement leur tête du bras lorsqu’on les interpelle. Des êtres sans forces qu’il faut soutenir dans les escaliers et guider dans leur marche, parfois hospitaliser immédiatement. Étienne Allemand revoit des scouts qui le descendent sur sa civière, il entend dans le lointain une Marseillaise et se réveille à la Salpetrière. C’était un homme de 80 kilos, il en pesait 39 à son arrivée à Romans. Que peuvent faire les dames de charité venues bénévolement renforcer des équipes médicales insuffisantes ?
L'hôtel Lutétia, dont on évacue les prisonniers de guerre encore présents, est réquisitionné. On appelle les médecins, infirmières, dentistes de la région. On accapare les stocks de lait en poudre, de pâtes, de riz, de biscuits. On aménage le grand hall de l'hôtel pour y placer les équipes d'accueil, les personnels médicaux et les services du renseignement chargés d'éliminer les faux déportés.
Très vite, les familles arrivent, mues autant par l’inquiétude que par l’espoir. Les cloisons sont couvertes de photos ou d’annonces placardées. Des scènes déchirantes se produisent quand personne ne répond à cette attente. De folles scènes de joie aussi lors de retrouvailles. Mais souvent, la famille ne reconnaît pas son déporté, non à cause des vêtements de bric et de broc, mais en raison de sa maigreur, de sa pâleur, de son visage de vieillard…: telle mère a en tête un jeune garçon plein de vigueur et ne voit qu’un homme maigre, voûté, ridé, vêtu d’oripeaux rayés ; tel homme avait vu partir une épouse fringante et ne retrouve qu’une femme sans âge, au crâne rasé, parmi d’autres toutes couvertes des mêmes haillons. Ici et là, des gens crient un nom, espérant au moins obtenir un renseignement par des camarades. Roger Algoud a vécu cela : « Une foule de civils, d’uniformes et de femmes s’était précipitée à l’annonce de ce retour de déportés français. Dans l’esprit des libérés pas du tout remis, ce fut un moment de panique, […] ces gens s’étaient mis à les apostropher, appelant au hasard, criant des noms, se trompant. Ça a duré un moment, ils croyaient tous reconnaître un visage ! »
Dans la presse de 1945, paraissent de multiples avis de recherche, auxquels, peu à peu, vont se substituer des listes interminables d’avis de décès dans les camps. Les familles des disparus, de ceux qui ne sont pas rentrés, espèrent toujours et continuent longtemps à piétiner dans le hall de la gare. Elles s’accrochent à l’idée que l’être cher survit peut-être quelque part. Aussi ne cessent-elles d’interroger les arrivants des camps et les services officiels pour en tirer le moindre renseignement, la moindre piste. Elles ont d’abord espéré que leur déporté était bloqué en Allemagne par la quarantaine imposée par les Alliés dans certains camps touchés par l’épidémie de typhus. Cet espoir a cessé. On ne peut que supposer la mort et c’est alors une torture morale longue à effacer. Comment ces gens imagineraient-ils que des milliers d’êtres humains aient ainsi disparu dans « la nuit et le brouillard » ?
Madame Mérandat, de La Roche-de-Glun, a vu revenir ses deux fils Roger et André, mais elle ne peut se faire à l’idée que son mari Louis ne rentrera pas : pendant un an au moins, elle ne cesse de croire à son retour, échafaudant des hypothèses sur ce qui aurait pu lui permettre de rester en vie. La nuit, au moindre bruit, elle est persuadée de l’entendre arriver. Il lui faudra longtemps pour admettre cette disparition.
Ce drame, bien des familles de déportés l’ont vécu : Albert Dupont est mort à Bergen-Belsen le 14 avril 1945, mais sa famille n’en a rien su. Son épouse et leurs trois enfants, ainsi que le jeune réfractaire qu’ils camouflaient, espèrent encore : « Pendant un an, tous les cinq nous l'avons attendu, tant bien que mal on a travaillé à la ferme pour vivre, aidés par nos plus proches voisins. Des camarades de camps sont venus, ceux qui ont pu résister à ce bagne. Ils ont expliqué à ma mère cet enfer.[…] Son copain de détention qui est venu chez nous après sa libération, nous a dit qu'il l'avait lui même enterré, enroulé dans sa couverture, et là s'est terminé le calvaire de mon père, de cette maudite guerre. Pour nous c'était fini, il n'y avait plus d'espoir, ma mère a donc tout vendu le matériel agricole et a cédé la ferme. Ma mère a acheté une petite épicerie, en 1945, rue Archinard à et ainsi a pu vivre et élever ses enfants : moi, 18 ans, Maryse, 6 ans, Simon à peine 2 ans, et la vie a continué ».
Les déportés se prêtent sans trop rechigner aux multiples questions des officiers du renseignement. Questionnement peu productif d’hommes et de femmes inertes, façonnés, derrière les barbelés, à ne plus s’occuper que de trouver quelque chose à manger, d’échapper aux coups et de vivre un jour de plus. « Des officiers et des médecins nous interrogeaient sur notre parcours concentrationnaire, ce que nous avions subi, etc. » dit Marcel Got. On leur a expliqué qu’il s’agissait de retrouver la trace de camarades disparus et de dépister les usurpateurs, STO plus ou moins volontaires se posant en victimes même s’ils sont partis attirés par l’appât du gain ou poussés par leurs convictions, kapos ou mouchards tentant de disparaître sous de fausses identités… Un exemple parmi tant d’autres, cette femme, Odette M, 28 ans, originaire de Châteauneuf-d’Isère, qui, le 29 mars 1944, part volontairement avec les Allemands, puis revient en 1945 en se faisant passer pour déportée, et s’installe à Suze (sur-Crest). C’est là que, au début juin 1945, les gendarmes la découvrent et la transfèrent à Valence où elle est écrouée.
À chaque déporté, une somme de 3 000 francs est remise ainsi qu’un costume. « On m’a donné une paire de chaussures à semelles de bois sciées en parties articulées et un beau costume marron, se souvient Marcel Got, j’ai jeté mes guenilles rayées avec plaisir ».
Le Romanais Robert Monier raconte qu’à l’hôtel Lutétia, on leur distribue à manger et à boire. Un verre de vin à chacun, c’était une ration de prudence, mais insuffisante pour certains qui rêvent de ce vin français depuis si longtemps ! L’un des amis de Robert Monier déniche une bouteille pleine et ne peut résister à la tentation de la boire. C’était évidemment l’erreur à ne pas commettre et le pauvre est mort peu après de ce plaisir inconsidéré.
Les déportés épuisés se laissent emmener vers les différents services d’hygiène et de santé : douche, désinfection, laboratoire, examens médicaux et dentaires, radiographies, soins, etc. L’épreuve ne s’arrête pas du jour au lendemain : les suites médicales, psychologiques, familiales… sont souvent longues et douloureuses. En très grand nombre, les déportés doivent faire un séjour en sanatorium pour y soigner la tuberculose : le sanatorium des Petites Roches à Saint-Hilaire-du-Touvet, dans l’Isère, le sanatorium des Neiges à Briançon et celui du Lac de Villers, dans le Doubs, accueillent de nombreux déportés drômois. De longs mois encore loin des siens. Et souvent des séquelles irréversibles.
Lorsque la guérison est assurée, les déportés reviennent dans la Drôme où ont été ouverts des centres de repos et de convalescence. Beaucoup de rescapés des camps témoignent de leur comportement et de l’état de conditionnement dans lequel ils sont encore : ils se rangent instinctivement par cinq pour se promener, ils ne peuvent dormir dans un lit …
Guy Eberhard est accueilli à l’hôtel Lutétia, puis rejoint Lyon en train, surpris qu’il faille une journée entière pour ce voyage, ignorant les multiples destructions de voies, de ponts… Dans les gares, des comités d’accueil se dépensent sans compter pour offrir du café ou des sandwiches aux déportés. Des femmes demandent des nouvelles des leurs, interrogent les déportés, persuadées que chacun d’eux a connu leur mari, leur frère, leur fils. Hélas, les réponses sont rares.
Auteurs : Robert Serre
Sources : AD Rhône, 3808 W 313, Rey-Robert René. ADD, 123 W 1, registre et fiches individuelles dans 99 W 6 (A à G) et 7 (H à Z), 132 J 2, 18, 80 à 84, 1500 W 24, 500 W 29, 348 W 13-14, 99 W 6, 180 W 64. Olga Wormser-Migot, Le retour des déportés. Quand les Alliés ouvrirent les portes…, éd. Complexe, Bruxelles, 1985. André Kaspi, Les Juifs pendant l’Occupation, Seuil Points Histoire, Paris 1997. V. Pozner, Descente aux enfers. Récits de déportés et de SS d’Auschwitz, Paris Julliard, 1980. Raymond Ruffin, La vie des Français au jour le jour, op cit. Annette Wievorka, Déportation et génocide, Plon, Paris 1992. Jeanne Deval, Les années noires, éd. Deval Romans, 1984. Robert Serre, De la Drôme aux camps de la mort, les déportés politiques, résistants, otages, nés, résidant ou arrêtés dans la Drôme, éd. Peuple Libre / Notre Temps, 2006. Extraits de « Mémoire de famille », rédigé par Ginette Dugand, la fille aînée d’Albert Dupont. Archives Maryse Renaudin, deuxième fille d’Albert Dupont. Journal Officiel du 12 mai 1945. Le Crestois, 9 juin 1945. Le Dauphiné Libéré, 27 juin 2004.

avec un de ses enfants dans les bras
Auteur : Inconnu - Sources : Le Lien, bulletin de la communauté Boimondau - DR
 Retour de Marcel Barbu déporté à Buchenwald
Retour de Marcel Barbu déporté à Buchenwald au milieu des employés de sa communauté
Auteur : Inconnu - Sources : Le Lien, bulletin de la communauté Boimondau - DR
 Le sanatorium des Petites Roches
Le sanatorium des Petites RochesSaint-Hilaire-du-Touvet (Isère).
Auteur : Inconnu - Sources : Archives Robert Serre - DR
 L’hôtel Lutétia à Paris
L’hôtel Lutétia à ParisAuteur : Inconnu - Sources : Archives privées Robert Serre - DR


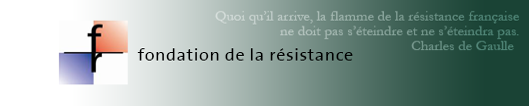
 Voir le bloc-notes
()
Voir le bloc-notes
()