Les Murs de Fresnes d'Henri Calet : le regard singulier d’un romancier sur les graffiti des prisonniers sous l’Occupation
Légende :
Henri Calet, Les murs de Fresnes, Paris, Editions des Quatre Vents, 1945
Genre : Image
Type : Ouvrage
Source : © Fondation de la Résistance Droits réservés
Détails techniques :
1 volume in-8°, 112 p. + photographies noir et blanc
Date document : Fin 1945
Lieu : France
Analyse média
Raymond-Théodore Barthelmess a eu une première vie d’aide-comptable saisi par le jeu au point de fuir en 1930 en Uruguay avec l’argent de son entreprise. Revenu sous l’identité d’emprunt d’Henri Calet, il est devenu un romancier de l’écurie Gallimard, vivant en semi-clandestin jusqu’à la prescription de sa condamnation par contumace. En juin 1940, il est fait prisonnier, s’évade, puis dirige en zone Sud une usine de céramique. À la Libération, il entre comme journaliste à Combat, recruté par son ami résistant Pascal Pia.
Les Murs de Fresnes paraît fin 1945 chez un nouvel éditeur littéraire, Les Quatre vents. Bien plus qu’un recueil de graffitis commentés, c’est une oeuvre d’art justifiant l’expression « monument en souvenir » de l’introduction : la composition en dix-sept chapitres, la sélection des graffiti, leur mise en page, tout révèle la volonté de Calet d’élaborer un livre cohérent, autour de thématiques fortes.
Premier constat : certes, le deuxième chapitre annonce un « annuaire de la Résistance » et le livre se clôt sur la photo de la tombe de Bertie Albrecht, après avoir consacré trois courts chapitres aux détenus Nacht und Nebel, au réseau Chapelle rouge (Rote Kapelle), au Journal de Juliette l’épouse d’un rédacteur de L’Humanité clandestine. Mais au-delà de cet hommage attendu, d’autres prisonniers sont présents par leurs graffiti au coeur du livre : beaucoup de soldats et aviateurs alliés (1) ainsi que quelques « droit commun ».
Deuxième constat : dès l’introduction Calet souligne que l’Occupation a été l’époque « des plus laides lâchetés » comme du « plus beau courage ». Il prépare ainsi le lecteur à un thème récurrent des graffiti : la trahison(2). Ainsi, la résistance coexiste avec son envers : la collaboration, ce qui explique sans doute, par souci d’équilibre, que les graffiti co-existent en fin d’ouvrage avec de nombreux documents émanant des bourreaux allemands.
Devant la face sombre de son sujet, Calet affiche son incapacité à juger ou comprendre, qu’il s’agisse des dénonciations (« On ne rougit même pas ; on ne sait plus. ») ou de l’Occupation (« cette étrange époque »). C’est que derrière cela, il y a plus grave encore : « Je crois que nous vivons le siècle de l’abjection » dit l’introduction (datée « Mai 1945 »), à propos de la découverte d’Auschwitz et de Dachau. Une seule fois, il y revient dans le livre, évoquant les inventeurs des fours crématoires : « On aimerait ne pas s’appeler "homme" comme eux ; on aimerait mieux être une bête… Ou s’expatrier très loin, changer de planète ».
L’urgence, pour Calet, n’est pas de se faire le juge ou l’historien d’un Mal encore innommable, mais de se préoccuper des victimes. Morts ou déportés, il craint que les prisonniers de Fresnes restent pour beaucoup anonymes, des disparus dont les graffiti risquent d’être les seules traces, elles-mêmes menacées d’un effacement inexorable (3). Dès lors, il choisit de se mettre en retrait, laissant le sens des graffiti émaner de certains d’entre eux (« Ne m’oubliez pas »), les interrogeant plutôt que de les expliquer (« un numéro de téléphone, mais pourquoi faire ? »). S’il les interprète, c’est pour tenter de dégager un sens commun, anthropologique, derrière les particularismes : « Des croix, des V, des avions… S’accrocher à quelque chose et s’envoler de là ».
On ne peut s’empêcher de penser que l’écrivain Calet paye ici une sorte de dette à la condition de prisonnier à laquelle lui-même a échappé (4). Son ambition de donner une dignité artistique aux graffiti transparaît aussi dans quatre chapitres scandant le livre : « Le Valeureux » (consacré aux textes et dessins d’un prisonnier (5)), « Wild Justice » (titre d’un livre recouvert d’inscriptions par des militaires alliés), La gamelle (gravée sur deux faces par deux détenus) et « Le journal de Juliette ».
Extrait de La Lettre de la Fondation n° 86, septembre 2016, p. VII.
Une version longue de cet article, avec des indications bibliographiques, est téléchargeable en PDF
Voir la version longue de l'article
Bruno Leroux
Notes
(1) Cf. notamment les chapitres 5 à 8.
(2) Thème récurrent jusqu'à l’avant-dernier chapitre, « Section des femmes », hommage aux prisonnières, qui se clôt paradoxalement par le graffiti d’un homme : « H.A. Évadé d’Allemagne vendu par une femme française ».
(3) «Le mur mange peu à peu les mots qu’on lui confie ».
(4) Cf. la digression que lui inspire la vision d’un « panier à salade » en 1945 : « Des escrocs, des petites voleurs, de grands criminels, peut-être… Des dénonciateurs, de ceux qui avaient vendu des patriotes aux Allemands…Je sais bien. Mais on voudrait tant qu’il n’y ait plus de prison. »
(5) Le prière d’insérer de l’édition originale renvoie à un de ses dessins : « Un coeur percé d’une flèche contient tout un roman ».


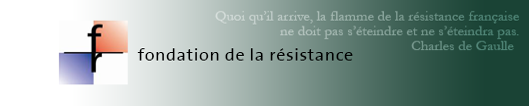
 Voir le bloc-notes
()
Voir le bloc-notes
()