Comment fabriquer la presse clandestine ? Ronéos et imprimeries
Légende :
Démonstration de l'utilisation d'une ronéo de type Gestetner par Xavier Aumage, archiviste au Musée de la Résistance nationale (Champigny-sur-Marne), en présence de Bruno Leroux, directeur historique de la Fondation de la Résistance. La ronéo utilisée provient de la collection du Musée de la Résistance nationale (don de Christian Vacheron).
Genre : Film
Type : Film
Source : © Fondation de la Résistance Droits réservés
Détails techniques :
Film tourné au Musée de la Résistance nationale (Champigny-sur-Mane) le 29 septembre 2016.
Date document : 29 septembre 2016
Lieu : France
Analyse média
La ronéo de la marque Gestetner est la plus courante des machines à « ronéoter » dans les années 1930. La faire fonctionner permet de comprendre les inconvénients mais aussi les avantages qu’offrait ce procédé pour les résistants, par rapport à l’imprimerie.
Bruno Leroux
Contexte historique
La plupart des journaux clandestins de la Résistance se résument à une ou deux feuilles A4 recto verso. On mesure mal aujourd’hui les difficultés innombrables à surmonter sous l'Occupation avant d'arriver à publier régulièrement une telle feuille : il fallait trouver des relais dans la presse légale et l’administration de l'Etat français pour obtenir des informations censurées, mais aussi convaincre des papetiers ou des imprimeurs de détourner une part de leur stock de papier (car les stocks étaient contingentés). Pour imprimer, le plus souvent il n'y avait pas d’autre solution que d’obtenir le concours régulier d'un imprimeur, et donc de le recruter pour la Résistance, car les achats de matériel d'imprimerie étaient rigoureusement contrôlés. A défaut, il fallait utiliser une « ronéo », la machine à reproduire utilisée couramment avant l’invention des photocopieuses de bureau.
Jusqu'en 1943, la presse clandestine est davantage ronéotée qu'imprimée. C'est seulement en 1944 que la proportion change. Cette année-là, quelques journaux de la Résistance parviennent, grâce aux techniques d'impression, à atteindre ponctuellement des tirages de 300 000 à 400 000 exemplaires. Mais la presse ronéotée est toujours abondante, car l'utilisation de la ronéo est plus simple, pose moins de problèmes de sécurité et convient bien aux petits tirages des feuilles locales ou spécialisées.
Bruno Leroux
Lou mestre d'escolo, février 1944
Musée de la Résistance nationale, Champigny-sur-Marne
 La presse manuscrite
La presse manuscriteJeunesse berrichonne, juin 1944
Musée de la Résistance nationale, Champigny-sur-Marne
 La presse dactylographiée
La presse dactylographiéeLe chant du grillon, n°1, 20 juillet 1944
Musée de la Résistance nationale, Champigny-sur-Marne
 La presse ronéotypée
La presse ronéotypéeStencil pour le recto du n° 195 du journal clandestin L'Humanité du 1er janvier 1943
Dimensions : 43 x 23,5 cm
Archives nationales, Z/4/76 , dossier 522, scellé 3 - droits réservés
 La presse ronéotypée
La presse ronéotypéeRésistance, n°1, 15 décembre 1940
Archives départementales des Yvelines, 300 W 51
 La presse ronéotypée
La presse ronéotypéeCollection Pierre Le Rolland, droits réservés
 La presse ronéotypée
La presse ronéotypéeDéfense de la France, n°1, 15 août 1941
Archives nationales, fonds Défense de la France (don association Défense de la France)
 La presse ronéotypée
La presse ronéotypéeParisienne patriote, juillet 1943
Archives départementales des Yvelines, 300 W 50
 La presse ronéotypée
La presse ronéotypéeLe Patriote de Dieppe et du pays de Bray, 1943
Musée de la Résistance nationale, Champigny-sur-Marne
 La presse imprimée (artisanalement)
La presse imprimée (artisanalement)Valmy, n°1, janvier 1941
Ce premier numéro du journal Valmy est reproduit à 50 exemplaires sur une imprimerie d’enfant.
Musée de la Résistance nationale, Champigny-sur-Marne
 La presse imprimée
La presse impriméeLa France continue, n°5, septembre 1941
Archives départementales des Yvelines, 1 W 167
 La presse imprimée
La presse impriméeL'ardèche combattante, n°3, mars 1944
Musée de la Résistance nationale, Champigny-sur-Marne
 La presse imprimée
La presse impriméeTémoignage Chrétien, n°10 [avril 1944]
Musée de la Résistance nationale, Champigny-sur-Marne
 La presse imprimée
La presse impriméeLa Marseillaise, n°11, juin 1944
Archives départementales des Yvelines, 300W50
 La presse imprimée
La presse impriméePlomb de la page 2 du journal Défense de la France, n° 45 d'avril 1944
Musée de la Résistance nationale, Champigny-sur-Marne
 La presse imprimée
La presse impriméePage 2 du journal Défense de la France, n° 45 d'avril 1944
Musée de la Résistance nationale, Champigny-sur-Marne
 La machine à écrire
La machine à écrireColl. Musée de la Résistance nationale, Champigny-sur-Marne - droits réservés
Cliché Denis Gliksmann
 Le matériel d'impression
Le matériel d'impressionRonéo de type Gestetner.
Coll. Musée de la Résistance nationale, Champigny-sur-Marne - Don de Christian Vacheron - droits réservés
Cliché Denis Gliksmann
 Le matériel d'impression
Le matériel d'impressionPhilippe Viannay présente au général Koenig une presse utilisée pour le journal Défense de la France lors de l'exposition d'après-guerre consacrée au mouvement éponyme. Défense de la France est un cas très rare de mouvement ayant fabriqué son journal par ses propres moyens, avec du matériel fourni par des imprimeurs professionnels, chez lesquels ses militants allèrent aussi se former.
Les quatre documents suivants appartiennent au reportage photographique effectué à l’occasion de cette exposition. Des résistants de Défense de la France y reconstituent des gestes de leur vie clandestine.
© Fondation de la Résistance - département AERI - droits réservés
 Le matériel d'impression
Le matériel d'impressionDans une usine d’Aubervilliers travaillant pour les Allemands, une des machines d’imprimerie de Défense de la France, camouflée sous des caisses d’expédition, qu’on soulevait pour imprimer les journaux clandestins, et qu’on rabaissait à la moindre alerte. L'impression de Défense de la France s'effectue initialement sur la Rotaprint. Mais, dès le début de 1943, le mouvement acquiert des machines professionnelles. Grâce à l'imprimeur Jacques Grou-Radenez, il se procure une presse très puissante de la marque Teisch (photo).
© Archives nationales, fonds Défense de la France (don Jean-Marie Delabre) – droits réservés.
 Le matériel d'impression
Le matériel d'impressionAu fond d’un lavoir, insonorisé par un revêtement de liège, une presse automatique tire 200 000 exemplaires d’un journal clandestin chaque semaine. Sur la photo, Pierre Martin.
© Archives nationales, fonds Défense de la France (don Jean-Marie Delabre) – droits réservés.
 Le matériel d'impression
Le matériel d'impressionJacqueline Borgel travaille à l'atelier de composition de Défense de la France, rue Jean-Dolent à Paris, printemps 1944.
© Archives nationales, fonds Défense de la France (don Jean-Marie Delabre) – droits réservés.
 Le matériel d'impression
Le matériel d'impressionPresse à journaux de grand format
© Archives nationales, fonds Défense de la France (don Jean-Marie Delabre) – droits réservés.


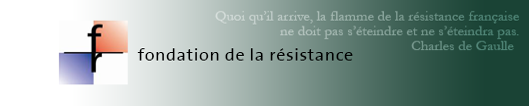
 Voir le bloc-notes
()
Voir le bloc-notes
()