Emmanuel Mounier et sa fille à Dieulefit
Genre : Image
Type : Portrait
Source : © IMEC - Fonds Éditions des Trois Collines Droits réservés
Détails techniques :
Photographie argentique noir et blanc.
Date document : 1943
Lieu : France - Auvergne-Rhône-Alpes (Rhône-Alpes) - Drôme - Dieulefit
Analyse média
Après sa libération, Emmanuel Mounier se réfugie dans la clandestinité à Dieulefit dans la Drôme. Sur cette photographie, on le voit en 1943, portant sa fille cadette sur ses épaules. Le photographe est probablement François Lachenal, diplomate suisse.
Auteurs : Jean Sauvageon
Sources : Paxton Robert O., Corpet Olivier, Paulhan Claire, Archives de la vie littéraire sous l’occupation. À travers le désastre, Editions Tallandier/IMEC, page 231. Dvd-rom La Résistance dans la Drôme-Vercors, éditions AERI-AERD, février 2007.
Contexte historique
Emmanuel Mounier, Grenoble 1905, Châtenay-Malabry 1950.
Influencé par Bergson, Maritain, Péguy, Emmanuel Mounier fonde la revue Esprit en 1932.
Il joue un rôle important dans le mouvement intellectuel, spirituel et politique entre les deux guerres. Dénonçant le désordre économique, spirituel du monde capitaliste et son individualisme bourgeois, il lui oppose son "personnalisme" qui tente de faire une synthèse du christianisme et du socialisme et préfère aux spéculations une pensée tournée vers l'action.
Il est anti munichois :
"Un pays qui fait profession de non-résistance au nom de sa tranquillité n'est pas un pays généreux, c'est un pays épuisé ; une nation qui ne désire que se maintenir, recule ; le faible tente le fort, la victime tente le bourreau."
Le 1er août 1940, à Lyon où il a rejoint le philosophe Jean Lacroix, Emmanuel Mounier professe :
"Il est urgent que chaque Français [...] se nettoie du besoin morbide d'accuser et de se décharger. Qu'il commence le procès des responsabilités en se disant : ''Moi-même ? Mon parti ? Mes idoles ? Mon milieu ? Mon pays ?"
Emmanuel Mounier pense que la guerre est finie.
Il estime que si le régime de Vichy est autoritaire, on peut y "trouver la place de la liberté"
Rejeter purement et simplement le nouveau régime, c'est donc renoncer.
Sa philosophie de l'engagement lui dicte une autre attitude, la politique de présence, l'occupation du terrain, voire, si c'est possible, un parasitage de la Révolution nationale par ses amis et ses idées.
La position de Mounier lui attire des reproches, surtout après la guerre. Zeev Sternhell propose une explication de la position de Mounier :
"Le cas Mounier est sans doute le plus intéressant, tout d'abord parce qu'il s'agit d'une personnalité hors pair, d'une droiture morale sans failles et dont l'influence fut considérable dans l'immédiat après-guerre. Sa réaction à la défaite et au régime de Vichy est à la fois complexe et très caractéristique de l'époque. Elle illustre bien la profondeur du malaise moral, le dégoût du régime et la volonté de changement. Si un Mounier accepte, pendant plus d'un an, de travailler dans le cadre du régime de Vichy, cela signifie que presque tout paraît alors préférable à un éventuel retour à ce qui avait été".
Aussi, toujours selon Zeev Sternhell :
"Ce refus du vieil ordre des choses amènera finalement Mounier à accepter le principe de la Révolution nationale; certes il en regrette amèrement les excès, mais ne réagit guère autrement que par un jeu de cache-cache avec la censure lyonnaise.
Le 19 octobre 1940 vient de paraître le honteux Statut des Juifs, et Mounier se sent vieilli comme par une maladie.
Le 25, arrivée de l'autorisation de reparution d'Esprit, la nouvelle des entrevues de Montoire ; Mounier est conscient de la profonde ambiguïté de la situation qui est en train de se créer".
Malgré des avis contraires, Emmanuel Mounier publie Esprit en novembre 1940.
Mais en même temps, il critique le statut des Juifs en utilisant Charles Péguy, philosémite et référence des idéologues de la Révolution nationale
Encouragé par Victor Serge, rescapé du Goulag, ce 1er numéro ne satisfait pas Emmanuel Mounier car il pense avoir fait trop de concessions à Vichy.
En juin 1941, la critique est plus directe contre Le Juif Süss : "Un film dont il faut heureusement ne pas incriminer le cinéma français, charge Israël de toutes les noirceurs de la terre. C'est beaucoup pour un seul peuple". Emmanuel Mounier félicite les jeunes qui ont chahuté dans les salles de cinéma de Lyon.
Il adhère aux Compagnons de France dont il est exclu dès novembre 1940.
C'est un des collaborateurs d'Uriage, début 1941. Il veut empêcher, là comme ailleurs, "la victoire spirituelle du nazisme sur la jeunesse française."
Pour certains, il s'est compromis.
À la fin de janvier 1941, il est sollicité par Pierre Schaeffer, présidant Jeune France, association loi 1901, sous la dépendance du secrétariat général à la Jeunesse de Georges Lamirand. Le but est de regrouper les artistes habitant ou réfugiés en zone non occupée. Emmanuel Mounier propose sa liste d'adjoints : Etienne Borne, Pierre Emmanuel, Jean Lacroix, Henri Marrou, etc.
Très vite l'action souterraine d'Emmanuel Mounier est dénoncée :
En juillet 1941, dans L'Action française, Pierre Boutang parle des : "niaiseries éculées du personnalisme mouniériste" ;
Dans La Gerbe, Marc Augier : "Le ‘'personnalisme'' est une doctrine néfaste que je rejette violemment au nom de l'ordre nouveau...".
Emmanuel Mounier est critiqué par Jean de Fabrègues de l'équipe élargie de Jeune France : "Emmanuel Mounier attaque parodiquement le Maréchal."
Loustau, ami de De Fabrègue, dénonce auprès de Pucheu le terrible danger Mounier ; " il faut s'attaquer au bolchevisme chrétien des PD (sic) avec vigueur. Vive la communauté humaine fraternelle et durement disciplinée et merde pour la personne humaine d' Emmanuel Mounier . Voilà le mot d'ordre."
La publication d'un texte "Suppléments aux mémoires d'un âne" est censurée.
Le 25 août 1941, Paul Marion, sur ordre de Darlan, interdit Esprit. Pour Emmanuel : "Pas l'ombre d'une tristesse ou d'une amertume. Le scénario se déroule comme je l'avais prévu, voulu. Il a seulement duré six mois de plus que je ne l'aurais cru".
Le 15 janvier 1942, Emmanuel Mounier est arrêté à Lyon pour complicité avec les activités du mouvement Combat.
Il est interné à Clermont-Ferrand, en résidence forcée dans la même ville, puis frappé d'internement administratif .
Le 2 mai 1942, il est conduit à Vals-les-Bains (Ardèche), à l'hôtel du Vivarais.
Le 18 juin, la BBC annonce : "Aujourd'hui, pour protester contre leur embastillage et les lois tyranniques du régime vichyssois, quatre Français ont commencé la grève de la faim : Emmanuel Mounier, Bertie Albrecht (secrétaire d'Henry Frenay), Jean Perrin et François - Régis Langlade".
En juillet, Mounier est transféré à la prison Saint-Paul à Lyon. Son procès dure du 19 au 25 octobre 1942. Le 30, "malgré des présomptions troublantes de culpabilité", Emmanuel Mounier est relaxé au bénéfice du doute.
Conseillés par Pierre Emmanuel, sous le nom de Leclercq, en mauvaise santé, Emmanuel Mounier et sa femme se réfugient à Dieulefit jusqu'en août 1944. Le couple est très discret, par précaution. Il sort peu de la pension de Beauvallon. Il reçoit une aide financière de Suisse, grâce à Albert Béguin, écrivain surréaliste.
Emmanuel Mounier termine à Dieulefit son Traité du caractère.
Le 7 juin 1944, Mounier s'engage dans un groupe de protection de parachutage, groupe surtout constitué par des grands élèves des classes secondaires de Dieulefit. Le 15 juillet 1944, le sous-préfet de Nyons, Majoureau, contacte Emmanuel Mounier, Pierre Emmanuel et Andrée Viollis pour mettre sur pied un hebdomadaire pour toute la Résistance dans la Drôme, intitulé Vercors. Le drame du Vercors empêche de le faire imprimer. Ils participent en août à la rédaction de : Le Résistant de la Drôme.
À Dieulefit, Emmanuel Mounier poursuit son oeuvre, collabore aux Cahiers politiques clandestins du Comité général d'études (CGE). Il publie des articles : avril 1943, "Problèmes sociaux de demain" ; juillet 1943, "Pourquoi je suis républicain ?", "Vers l'avenir dans la clarté" ; éditorial, en novembre 1943, "Pour la France de demain. Libres réflexions d'un catholique de la Résistance".
Deux "congrès" clandestins d'Esprit se tiennent à Dieulefit avec Paul Flamand, Henri Marrou, Pierre Emmanuel, André Mandouze, Gilbert Dru (fusillé par les Allemands en 1944), Hubert Beuve-Méry.
Dès décembre 1944, Esprit reparaît.
Après la guerre, Emmanuel Mounier voyage beaucoup. Il est un acteur fervent de la réconciliation franco-allemande. En 1948, il crée le Comité français d'échange avec l'Allemagne nouvelle. L'oeuvre de Mounier échappe à ce que l'on appelle la crise des idéologies.
Une définition du personnalisme résume très bien la pensée de Mounier : la place fondamentale de la personne humaine : "Nous appelons personnaliste toute doctrine, toute civilisation affirmant le primat de la personne humaine sur les nécessités matérielles et sur les appareils collectifs qui soutiennent son développement."
Emmanuel Mounier meurt le 22 mars 1950 d'une crise cardiaque. La revue Esprit continue de paraître.
Des jugements sévères ont été portés sur Emmanuel Mounier, notamment sur sa position pendant les premiers mois du gouvernement de Vichy.
Pourtant dans les années trente, l'antifascisme d'Emmanuel Mounier est affirmé dès les premiers numéros d'Esprit, doublé de la critique durable du libéralisme. Il rejoint en cela la critique marxiste.
Mais Emmanuel Mounier n'est pas marxiste. Son dernier éditorial d'Esprit montre quand même une sympathie certaine pour le communisme. Il serait plutôt socialiste autogestionnaire, inspiré de Proudhon, hostile également au régime capitaliste et au système parlementaire.
Or les fascistes se réclament eux aussi de l'anticapitalisme et de l'antiparlementarisme ; ils en appellent à une révolution autre que marxiste.
Certains font ainsi l'amalgame Emmanuel Mounier - fascisme. Le philosophe aurait eu sa "tentation vichyste", ce en quoi il ne diffère guère de la majorité des Français.
Ce rapprochement est très discutable quand on lit les textes d'Emmanuel Mounier. Il a attaqué l'agression éthiopienne, la croisade franquiste. Il a été antimunichois.
Le procès intenté à Emmanuel Mounier s'est nourri de la période 1940-1941. L'écrivain est accusé d'un ralliement à la Révolution nationale. En 1940, et au moins jusqu'à la fin de la bataille d'Angleterre, comme pour beaucoup, Emmanuel Mounier a jugé que la guerre était finie.
Il n'a pas perçu, comme De Gaulle, la dimension mondiale du conflit ; il n'a pas eu la lucidité politique des résistants de la première heure.
Spéculant sur une Europe en passe de devenir totalitaire et de le rester longtemps, il en a déduit une stratégie intellectuelle et spirituelle, sinon dans le régime de la Révolution nationale, du moins à travers celui-ci.
L'histoire lui a donné tort. Souhaiter tranquillement la victoire anglaise avait paru trop facile aux yeux d'Emmanuel Mounier. Il lui fallait agir, et il agit avec ses propres moyens, qui étaient ceux d'un homme physiquement handicapé (sourd d'une oreille, il avait aussi perdu l'usage d'un oeil depuis ses treize ans) mais d'une débordante énergie intellectuelle.
Refusant tous les régimes qui se disputaient l'Europe d'avant 1940, aussi bien les régimes totalitaires que la démocratie parlementaire, Emmanuel Mounier n'avait pas de solution, contrairement à De Gaulle, lui aussi antilibéral, antimarxiste et antifasciste, mais sachant à quel régime constitutionnel se vouer. Il ne cesse de répéter qu'il n'intervient pas en politique, qu'il faut relativiser le politique, que la primauté du spirituel doit présider à toute reconstruction d'une vie publique. Il croit donc pouvoir combattre la "contagion du nazisme" en préservant, là où il est, les chances de la "révolution spirituelle" à laquelle il aspire.
Auteurs : Alain Coustaury
Sources : Dvd-rom La Résistance dans la Drôme-Vercors, éditions AERI-AERD, février 2007.


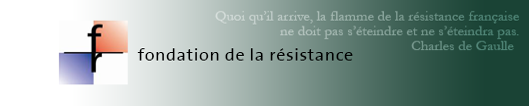
 Voir le bloc-notes
()
Voir le bloc-notes
()